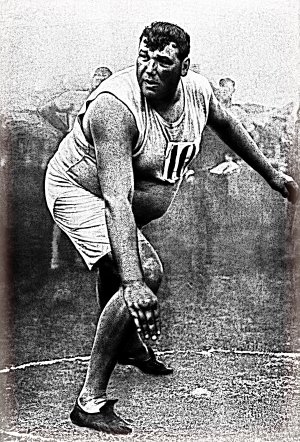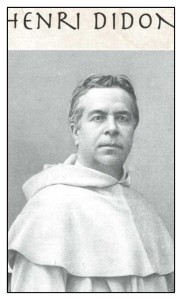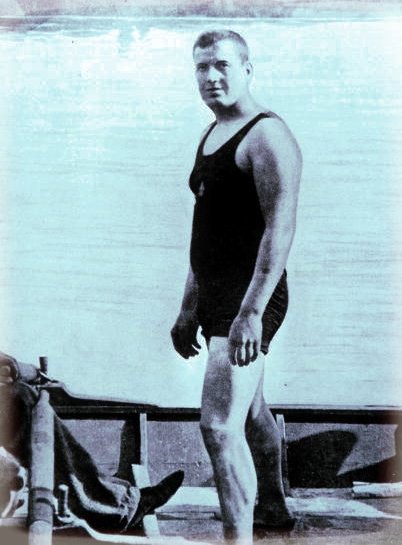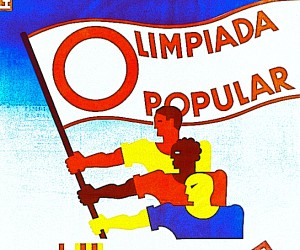Présente aux Jeux Olympiques durant seulement 20 ans (1968-1988),
la R.D.A. s’est à l’époque affirmée comme une grande puissance sportive
mondiale. Ainsi, aux Jeux d’été, en cinq participations (1968, 1972, 1976,
1980, 1988), la R.D.A. a obtenu 409 médailles, dont 153 en or. En six éditions
des Jeux d’hiver (1968-1988), la R.D.A. a remporté 110 médailles, dont 39 en
or.
Comment expliquer qu’un tout petit pays ait pu rivaliser avec les États-Unis et l’U.R.S.S. aux Jeux ? Cette réussite – qui s’avérera une supercherie après la chute du Mur de Berlin en 1989 – s’appuyait sur une démarche parfaitement planifiée, laquelle résultait d’une volonté politique de reconnaissance internationale grâce à la vitrine olympique : « Le sport n’est pas un but en soi ; il est un moyen d’atteindre d’autres buts », déclara notamment Erich Honecker, président du Conseil d’État de la R.D.A. de 1976 à 1989.
Une
politique sportive volontariste
Le modèle sportif est-allemand se distinguait par une structure
organisationnelle originale. En effet, selon les pays, le sport tient ou ne
tient pas une place importante dans le système éducatif, ce statut étant
souvent issu de la tradition (Grande-Bretagne). Puis une élite se dégage de la
masse de ces sportifs en herbe. En R.D.A., l’accès au sport était garanti à
tous par la Constitution, comme « élément de la culture socialiste servant
à l’épanouissement de la population ». Mais, parallèlement à ce sport de
masse, un système de détection perfectionné permettait de « choisir »
les enfants aux capacités prometteuses et de les « former » à la
haute compétition dans de multiples centres d’entraînement, dès l’âge de dix ou
onze ans, parfois plus tôt. Ainsi, les enfants se mesuraient lors de
« Spartakiades d’arrondissement », ce qui permettait de recruter les
meilleurs d’entre eux. Les archives de la Stasi indiquent que plus de 35 000
cadres et entraîneurs rémunérés travaillaient dans quelque 2 000 centres à
la formation et à la « préparation » de futurs champions soumis à une
sélection drastique. La dissociation totale entre pratique sportive de masse
– de « loisir », dit-on en Occident – et
« formation » plus que rigoureuse à la compétition de haut niveau
explique la réussite olympique de la R.D.A., laquelle ne peut pas se résumer à
la seule efficacité du dopage d’État.
Une
difficile accession aux Jeux
Après la Seconde Guerre mondiale, le président du C.I.O.
J. Sigfrid Edström souhaitait ardemment réunir l’ensemble du mouvement
olympique, et il fit de cet objectif la priorité de son mandat. Ce
rassemblement passait bien sûr par le retour aux Jeux des puissances vaincues
de la Seconde Guerre mondiale, le dossier de l’Allemagne s’avérant le plus
complexe. La partition de l’Allemagne, en 1949, a donné naissance à deux
États : la République fédérale d’Allemagne (R.F.A.) et la République
démocratique allemande (R.D.A.). Les deux pays devront attendre septembre 1973
pour intégrer l’Organisation des nations unies, mais la R.F.A. fut rapidement
associée aux affaires du monde, alors que la R.D.A. demeurait considérée comme
« zone soviétique » de l’Allemagne.
Après les Jeux de Londres (1948), deux Allemands retrouvèrent leur siège au C.I.O. : Karl Ritter von Halt, président du comité d’organisation des Jeux d’hiver de Garmisch-Partenkirchen en 1936 et proche collaborateur du Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, et le duc Adolphe-Frédéric de Mecklembourg ; les accointances des deux hommes avec les nazis ne semblèrent pas poser de problème au mouvement olympique… L’un et l’autre considéraient qu’ils ne représentaient que la R.F.A. Le Comité olympique ouest-allemand fut reconnu dès 1949 par le C.I.O. ; la R.F.A. fut conviée aux festivités olympiques dès 1952. La R.D.A. se dota également d’un comité olympique, mais celui-ci ne fut reconnu par le C.I.O. qu’en juin 1955, à titre provisoire, puis de manière définitive après les Jeux de Melbourne (1956).
Les deux comités olympiques allemands durent donc cohabiter, et
ils furent contraints de présenter une équipe commune aux Jeux Olympiques de
1956 à 1964, laquelle défilait derrière le même drapeau – l’oriflamme
traditionnelle aux bandes horizontales noire, jaune et rouge, agrémentée des
anneaux olympiques –, alors que, en l’honneur des vainqueurs, on jouait l’Hymne à la joie de Beethoven et non pas
les hymnes nationaux ouest-allemand ou est-allemand. La situation changea le
8 octobre 1965 : lors de sa session de Madrid, le C.I.O. accepta,
malgré les réticences occidentales, que les deux Allemagnes présentent chacune
leur propre équipe en 1968 aux Jeux de Grenoble et de Mexico. Dès lors, le
maillot bleu nuit aux lisérés blancs siglé « DDR » va devenir un
vêtement olympique à la mode. À partir de la fin de 1969, le chancelier
ouest-allemand Willy Brandt mit en œuvre l’Ostpolitik,
les deux pays se reconnurent mutuellement en décembre 1972. Ils intégrèrent
l’O.N.U. le 18 septembre 1973. Le monde pouvait-il continuer d’ignorer la
R.D.A., un pays dont les sportifs commençaient de squatter les podiums
olympiques ?
Une
fusée olympique à plusieurs étages
Dans l’esprit des dirigeants politiques de la R.D.A., participer
aux Jeux ne signifiait nullement y faire de la figuration, mais bien remporter
des médailles. Le pays s’appuyait certes depuis longtemps sur l’efficacité de
son système de détection et de « préparation » des futurs champions,
mais il développa aussi sa politique olympique selon deux axes forts :
obtenir tout de suite des médailles en mettant d’abord l’accent sur les
disciplines « secondaires » des Jeux, délaissées par les grandes
puissances sportives, avant de s’attaquer aux sports phares des Jeux d’été
(athlétisme et natation) ; présenter une délégation féminine redoutable,
car le sport féminin ne constituait pas une priorité en Occident, ce qui laissait
de nombreuses places potentielles sur les podiums.
Aux Jeux de Mexico, en 1968, la R.D.A. (9 médailles d’or, 25 médailles au total) se positionnait déjà à la cinquième place du classement des nations, devant la R.F.A., huitième (5 médailles d’or, 26 médailles au total). Pour les deux Allemagnes, les Jeux de Munich, en 1972, constituaient un rendez-vous essentiel : l’affrontement sportif devenait une question de suprématie locale. Le duel allemand vit une nette victoire de la R.D.A. (20 médailles d’or, 66 médailles au total), troisième place du bilan, alors que la R.F.A., « humiliée » par sa voisine sur son sol, n’était que quatrième (13 médailles d’or, 40 médailles au total). Walter Ulbricht, président du Conseil d’État de la R.D.A., se félicita des succès de ces « diplomates en survêtement »…
En 1976, aux Jeux de Montréal, la R.D.A. se classa deuxième au
bilan des nations, derrière l’U.R.S.S., mais devant les États-Unis. La fusée
olympique est-allemande avait déployé son deuxième étage et, son assise dans
certains sports « annexes » étant établie, elle s’était s’attaqué aux
disciplines reines des Jeux d’été : l’athlétisme et la natation. En
athlétisme, grâce aux performances de son équipe féminine (9 médailles d’or sur
14 possibles, 19 médailles au total), elle occupait la première place (11 médailles
d’or, 27 médailles au total). En natation, les gamines prises en main depuis
une dizaine d’années arrivaient à « maturité », c’est-à-dire qu’elles
étaient âgées de quinze à dix-huit ans : les nageuses est-allemandes aux
larges épaules remportèrent 11 des 13 épreuves !
Le « projet » olympique est-allemand avait abouti ; le dernier étage de la fusée consistait à le pérenniser. Lors des caricaturaux Jeux de Moscou, en 1980, la R.D.A. obtint 47 médailles d’or et 126 médailles au total. En 1988, à Séoul, à l’occasion de Jeux débarrassés des boycottages ou presque, la R.D.A. s’adjugea 37 médailles d’or et 102 médailles au total ; comme à Montréal, elle se classa deuxième du bilan des nations, derrière l’U.R.S.S., mais devant les États-Unis.
La révélation d’une imposture
La chute du Mur de Berlin, en novembre 1989, ne signifia pas la
mise au ban des sportifs est-allemands. Ceux-ci intégrèrent l’équipe de
l’Allemagne unifiée qui participa aux Jeux en 1992, car le chancelier Helmut
Kohl se prononça en faveur du maintien d’un sport de haut niveau en Allemagne.
Aux Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville, la réunification allemande a permis un beau résultat : l’Allemagne occupait la première place du bilan, avec 10 médailles d’or et 26 médailles au total. Parmi les lauréats figuraient plusieurs champions et championnes naguère est-allemands : Uwe-Jens Mey, Gunda Niemann, Jacqueline Börner (patinage de vitesse), Stefan Krausse et Jan Behrendt (luge), Antje Harvey (biathlon), entre autres. Mais l’embellie ne dura que le temps d’un printemps. En effet, aux Jeux d’été de Barcelone, l’équipe de l’Allemagne unifiée connut un semi-revers : elle se classa certes troisième du bilan des nations, mais, avec 33 médailles d’or et 82 médailles au total, elle n’égalait pas le résultat de la seule R.D.A. en 1988 (37 médailles d’or, 102 médailles au total). En outre, c’est surtout le bilan médiocre de la délégation féminine qui interpellait : les Allemandes s’adjugèrent 20 médailles (dont 10 en or), alors que les Allemandes de l’Est avaient remporté 51 médailles (dont 20 en or) à Séoul ; en natation, une seule Allemande fut championne olympique (Dagmar Hase, issue de la R.D.A.), alors que les Allemandes de l’Est s’étaient adjugé 11 médailles d’or en 16 courses à Séoul !
En fait, seules deux championnes qui se distinguèrent sous le
maillot de la R.D.A. continueront réellement d’enrichir leur palmarès sous les
couleurs de l’Allemagne unifiée : Birgit Fischer (kayak) et Heike
Drechsler (athlétisme).
La Stasi a détruit beaucoup de ses archives avant la chute du Mur,
mais pas toutes. L’analyse des documents restants permettra de révéler toute la
mécanique sportive est-allemande, instituée au mépris de l’éthique mais surtout
de la santé des sportifs. « Médecins » et « scientifiques »
avaient carte blanche pour élaborer les plus sophistiquées des techniques de
dopage et contourner les contrôles. Plus de 10 000 sportifs ont subi ce
dopage contraint. Des programmes dénommés « u.M » (unterstützende Mittel, « moyens de
soutien ») planifiaient soigneusement le dopage, qui touchait chaque année
2 000 personnes, surtout les filles : toutes ces gamines absorbaient
des pilules qualifiées de « vitamines » par leurs entraîneurs (il
s’agissait le plus souvent de stéroïdes anabolisants et de produits androgènes
qui entravaient leur maturation sexuelle, provoquaient une acné sévère et une
altération de la voix). Avant toutes les grandes compétitions internationales,
des tests antidopage « locaux » permettaient de s’assurer que les
contrôles officiels donneraient un résultat négatif : en cas de doute, le
sportif n’était pas inscrit pour la compétition…
Des procès eurent certes lieu : en 2000, les deux plus hauts responsables du sport est-allemand, Manfred Ewald, président de la Confédération des sports de la R.D.A. de 1963 à 1968 et président du Comité olympique est-allemand de 1973 à sa dissolution, et Manfred Höppner, directeur du Service de médecine sportive est-allemand, furent condamnés par un tribunal de Berlin pour « complicité de blessures corporelles » sur 142 jeunes athlètes est-allemandes. Leurs peines : 22 mois et 18 mois de prison respectivement, avec sursis. Un verdict bien clément au regard de milliers de vies brisées et de 20 années d’imposture olympique…
©Pierre LAGRUE