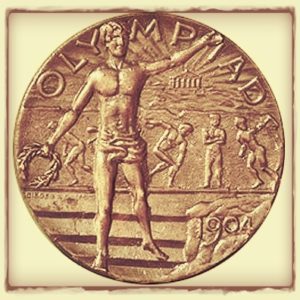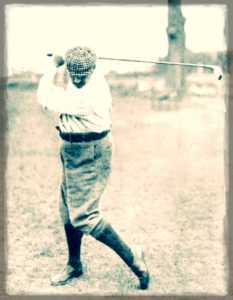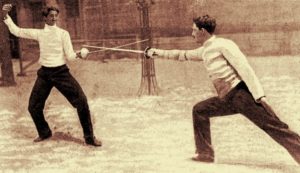Des renoncements en série…
La candidature de Budapest à l’organisation des Jeux Olympiques d’été de 2024 est pour l’instant suspendue. En effet, le mouvement Momentum Mozgalom, qui mène une campagne NOlimpia, a réuni dès la mi-février 2017 le nombre de signatures nécessaires pour qu’un référendum se tienne sur la question. Un référendum dont l’issue ne fait guère de doute. Après Boston, Hambourg et Rome, Budapest devrait à son tour jeter l’éponge. À chaque fois, les raisons étaient politiques et/ou économiques: référendum municipal pour Hambourg (novembre 2015); refus du maire pour Boston (juillet 2015) et pour Rome (octobre 2016). Une décision qui s’inscrit dans un processus lourd de renoncement aux Jeux, puisque, pour les Jeux d’hiver de 2022, quatre villes avaient renoncé en cours de route (Oslo, Stockholm, Lviv, Cracovie). Les coût exorbitants (30 milliards d’euros pour Sotchi en 2014), le manque d’héritage (le Parc olympique de Rio 2016 est déjà en ruine) expliquent cette frilosité. Ainsi, pour 2024 comme pour 2022, seules deux villes vont sans doute rester en compétition, une situation qui inquiète le Comité international olympique (C.I.O.).
Pourtant, il ne s’agit pas d’une première. Rappelons notamment que, pour les Jeux d’hiver de 1976, Denver, ville désignée, avait renoncé aux Jeux à la suite d’un référendum ou que, pour les Jeux d’été de 1984, seule Los Angeles était en course.
©Pierre LAGRUE
 À l’occasion des Jeux Olympiques de 1936, Berlin devait affirmer sa grandeur colossale. La ville fut toilettée pour les Jeux. Sur ordre de Julius Lippert, commissaire d’État de Berlin, les «éléments défigurant Berlin» furent éliminés. Ces «éléments» étaient les façades négligées, les édifices en ruine, mais aussi les Gitans, parqués par centaines dans un sinistre terrain vague entouré de fils barbelés… Sinistre présage.
À l’occasion des Jeux Olympiques de 1936, Berlin devait affirmer sa grandeur colossale. La ville fut toilettée pour les Jeux. Sur ordre de Julius Lippert, commissaire d’État de Berlin, les «éléments défigurant Berlin» furent éliminés. Ces «éléments» étaient les façades négligées, les édifices en ruine, mais aussi les Gitans, parqués par centaines dans un sinistre terrain vague entouré de fils barbelés… Sinistre présage.